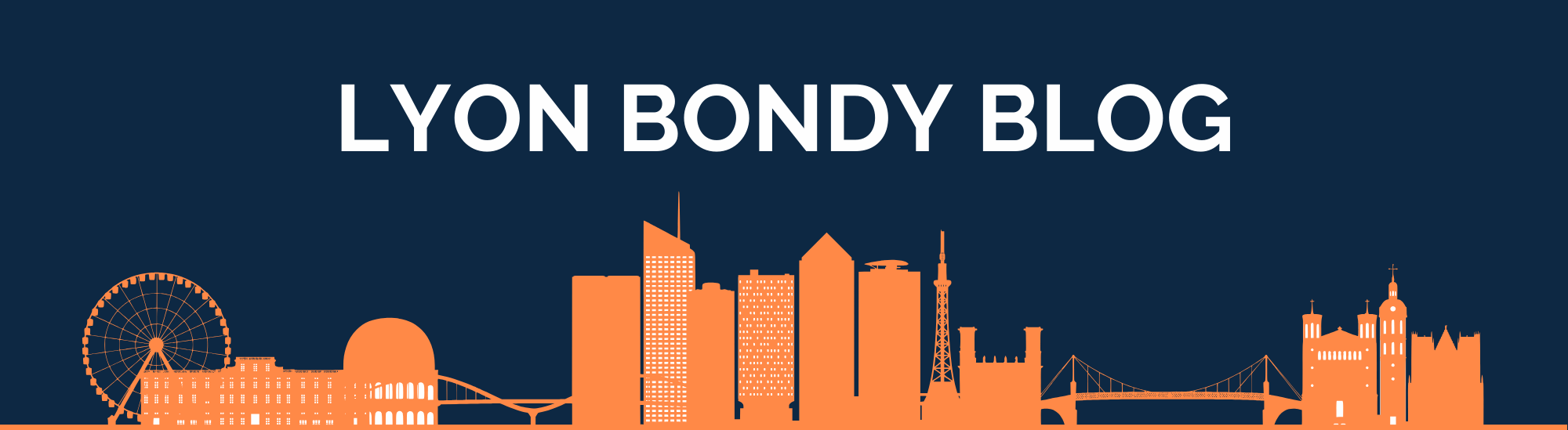« Si la mouette est rieuse, c’est que le thon a de l’humour » est un roman de Marianne Granier, qui se déroule dans un café parisien. Le lecteur fait la rencontre des personnages qui fréquentent le lieu et suit le fil de leur vie. Entretien avec l’autrice pour en savoir plus.
Bien que le titre puisse faire penser à un conte pour enfant, « Si la mouette est rieuse, c’est que le thon a de l’humour » est un roman décalé écrit par Marianne Granier. L’histoire se déroule dans un café parisien tenu par une certaine Macha (de son vrai prénom Martine) appelé « Si la mouette est rieuse », ou plus simplement « La Mouette ». Ce lieu de vie regroupe plusieurs personnages. On y retrouve un plombier, un ancien chirurgien, deux sœurs, dont l’une atteinte d’Alzheimer et l’autre ancienne actrice porno et prostituée, un étudiant en arts visuels. Des gens complètement différents qui se croisent au détour d’une quiche, d’une bière ou d’un… Chocolator ! Grâce à la « La Mouette », chacun d’une manière ou d’une autre se lie aux autres protagonistes. Tout au long du récit, on apprend à les connaître, en se plongeant dans leur point de vue, leur histoire et mêmes leurs mésaventures.
Ce paisible équilibre se fragilise lorsque des contrôleurs sanitaires viennent exiger des travaux pour que le café soit conforme aux normes. Macha n’a pas les moyens de rénover « La Mouette » autant qu’ils le demandent. Elle essaie tant bien que mal de gérer le problème avec ses amis, des habitués du café, mais se retrouve dans une situation bien compliquée.
Marianne Granier a commencé à écrire ce premier roman en mai 2018, a mis le mot de la fin en novembre 2019 et l’a publié en ligne, passant par l’auto-édition, en mars 2020. Puis après l’avoir envoyé à plusieurs maisons d’édition, les éditions 123 lui ont répondu rapidement. Enfin concrétisation : elle signe le contrat et le livre paraît en mars 2021. Depuis le mois de novembre 2021, il est en vente dans toutes les librairies (avant France Loisirs avait l’exclusivité). À l’occasion de la promotion de son livre, l’autrice, Marianne Granier a répondu à nos questions. Elle est originaire de Lyon mais n’y est restée pourtant que quatre ans dans sa vie, et pour cause : elle n’a cessé de changer de villes ou même de pays de résidence.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je n’aime pas trop les trucs linéaires alors je vais plutôt vous dire ce que j’aime et ce que je n’aime pas dans la vie, plutôt qu’un CV. Je suis quelqu’un de nomade, je n’aime ni être ancrée quelque part, ni être ancrée dans des idées. J’ai quitté la France depuis 32-33 ans maintenant. Dès mon enfance, on déménageait tout le temps en France avec mes parents, je n’ai jamais habité quelque part plus de 2 ou 3 ans d’affilés. Le seul endroit où j’ai habité longtemps c’est l’Italie ; on y est restés 10 ans. J’aime les rencontres, j’aime beaucoup être surprise. Quand on voyage, il y a plein de gens qui gravitent autour de nous et ça, ça m’intéresse parce que je trouve que toutes les vies sont dingues. Toutes les vies sont intéressantes, pétillantes. Et puis, je vais vous parler de mes enfants. J’ai trois garçons et j’ai découvert l’amour qui n’a pas de limites, qui nous dépasse totalement. À part ça, je suis une grosse gourmande, j’aime énormément faire la fête, je peux danser jusqu’à 4 ou 5 heures du matin. Et puis j’aime les cafés ; c’est pour ça aussi peut-être que « La Mouette » se passe dans un café. C’est vraiment un lieu de rencontres par excellence. C’est le miroir du monde, comme les halls d’aéroport ou de gare, là où les gens se croisent et se décroisent, partagent un moment important, quelques chose de banal ou même ne partagent rien. J’adore écrire dans les cafés, et je regarde la vie autour de moi. Cette définition est celle qui se rapproche le plus de moi aujourd’hui.
Avant d’écrire ce livre, qu’est-ce que vous avez fait professionnellement ?
J’ai la chance d’avoir eu plusieurs vie comme les chats. J’ai fait une école de commerce et j’étais la caricature d’une business woman, j’ai beaucoup travaillé à l’étranger dans une multinationale de cosmétique. Ça m’a plu de donner 15-20 ans de ma vie à une société dont l’essence même, l’ADN même était de populariser la beauté, de la rendre accessible au plus grand nombre. Et puis dans d’autres vies, quand ça, ça s’est arrêté, j’ai fait un petit peu de conseils et après j’ai donné des cours sur mon métier, le marketing. J’ai été prof pendant 7 ans en master en école de commerce. C’était un moment très fort ; j’ai adoré le contact avec les étudiants. J’ai fait pas mal de traduction aussi, j’ai traduit des journaux italiens en français quand je vivais en Italie. C’est vraiment le hasard qui a fait courir la plume sur des canards francophones à l’étranger. À l’issue de mes articles, j’ai vu de plus en plus de gens venir me dire : « Qu’est-ce qu’on s’est marré », « Merci c’est trop drôle », « Continue ! ». C’était tellement encourageant que je me suis dit « tiens, t’as peut-être un truc dans les doigts , t’as peut-être un truc que tu peux donner ». Je pense qu’il faut donner aux autres ce qu’on sait faire de mieux, je me suis dit que ce que j’avais à donner c’était peut-être mes mots. J’ai écrit pendant 7 ou 8 ans des billets d’humeur et je choisissais vraiment des sujets qui étaient d’actualité. Je n’ai aucune formation de journaliste hélas, donc on va dire que j’étais plutôt pigiste. Je choisissais des sujets sur lesquels on nous prenait pour des quiches : les régimes, les superstitions. Je me suis toujours appliquée à dire des choses sérieuses sans me prendre au sérieux. Au fil du temps, j’y ai vraiment pris goût parce qu’il y avait cet échange ; je n’écris pas pour moi, j’écris pour créer des émotions, pour transmettre quelque chose. J’ai vraiment kiffé ! Je faisais une rubrique de cinéma italien aussi et j’avais un « divinoscope », pour me moquer de l’horoscope, qui peut abuser de la crédulité des gens, du type « Vous êtes corneille, ascendant mal lunée ». C’était complètement loufoque. Après les articles, j’ai eu plus de temps. Je suis partie en Corée du Sud, je faisais de l’associatif et je me suis lancée dans les concours de nouvelles littéraires. Comme j’en ai gagné quelques uns, ça m’a vachement encouragée. Puis en arrivant au Panama, j’ai tenté d’apprendre l’espagnol et j’ai commencé à écrire mon premier roman. Ça a été un vrai bonheur.
Est-ce que vous l’avez écrit dans des cafés justement, ce premier roman ? Est-ce que vous avez observé et vous êtes inspirées des gens ?
Totalement. Au Panama, j’ai deux trois cafés sympas où je me pose. Gloria, la copine de Macha, je l’ai vu passer devant moi un jour au mois de mai. Elle était dingue ! Elle était juchée sur des talons hauts, elle avait des seins et des fesses rebondies, le cheveu crépu, elle était trop serrée dans un tailleur pantalon qui lui allait pas terrible. Mais c’était une reine ! Je l’ai vu passer donc ça ne dure pas très longtemps, peut-être 20 secondes. Je me suis dis « Mais bien sûr ! Mais évidemment ! Gloria c’est elle ». J’ai pris trois notes sur l’impression qu’elle m’a donné, celle d’être une lionne dans la savane et d’avoir cette joyeuse arrogance. Celle que je n’ai pas vu dans un café mais que j’ai tout de même croisé, c’est Lola, ma tendre prostituée complètement cassée. Je l’ai croisée à Milan, elle s’appelle Anna-Maria. On habitait un quartier où les trottoirs étaient extrêmement décorés par des dames de plus de 50 ans. Ce n’était pas la prostitution terrible, elles racolaient en Audi A3 avec des visons en hiver. On discutait et j’ai pris de grosses claques sur les idées reçues de l’existence. C’était des nanas qui avaient des enfants, une vie, des soucis, des impôts à payer. Alors Lola, ce n’était pas que Anna-Maria, mais un peu tout le trottoir.
Macha, elle, n’existe pas en tant que telle, mais quand on vient du marketing comme moi, on a un peu trempé dans la pub. J’ai invité de façon très vague mon monde. Ce que j’aime vraiment ce sont les choses inattendues, les trajectoires qui dérivent et c’est le cas de Macha. Elle s’est un peu ouverte à ce café pour lequel elle a eu un coup de foudre. Ce n’était pas sa destinée mais elle y est restée. Ça m’a intéressée de la mettre en scène, de l’imaginer derrière ce comptoir. J’ai déjeuné un jour à Paris dans le 12ème arrondissement dans une toute vieille brasserie faite de bric et de broc et derrière le comptoir, il y avait une nana dingue. On aurait dit qu’elle sortait d’un tableau de Toulouse-Lautrec, à elle toute seule c’était une nouvelle de Guy de Maupassant. Elle était très en chair et conquérante. Ce n’était pas une beauté mais elle était d’une féminité victorieuse dans sa robe rouge, avec son rouge à lèvre, qui se foutait pas mal des poncifs et des codes. J’ai aussi adoré l’endroit : des tables avec des nappes à carreaux, une carte incroyable. « La Mouette » et Macha sont nés ce jour, je pense.
Pourquoi avoir choisi d’appelé votre café « La Mouette » ?
Il y a trois explications. La première, c’est que mon papa lisait énormément de bandes dessinées et quand j’ai su lire, j’étais plongée dans Astérix et Gaston Lagaffe. Dans Gaston Lagaffe, il y a son chat et sa mouette, et la mouette est rieuse. Ça m’a fait trop marré de voir cette bête, une mouette rieuse, qui fout la panique partout. Et dans les fameux billets d’humeur que j’écrivais, dont je vous parlais, une fois j’ai voulu passer en revue toutes les expressions françaises qui contenaient des noms d’animaux. Je me suis dit pourquoi pas « Et si la mouette est rieuse, c’est que le thon a de l’humour ». Cette phrase, elle m’a fait marrer. Je me souviens encore d’avoir posé le stylo et me dire « Cocotte, si un jour t’écris un livre, ce sera le titre de ton bouquin ». Donc le jour où j’ai dû écrire un livre, c’était forcément le titre. Par contre, ça a été un peu coton de faire rentrer une histoire avec un titre pareil. Ça a été le nom de ce café et après je m’en suis sortie en créant l’idée du concours sur l’ardoise ; au lieu d’avoir les menus du jour, il y a la phrase du jour. Ça a été ma petite pirouette pour m’en sortir et faire rentrer mon titre un peu branque dans une histoire.
Je vous entend dire « kiffer », et dans l’instant d’après « poncif ». Ça représente bien votre roman ; il y a un langage très varié, vous utilisez le mot « pute » ou même « daron » et plus loin, des expression comme « statufié ces dames ». Pourquoi avoir choisi cette liberté dans les mots ?
D’abord, merci pour cette réflexion qui me touche vraiment parce que ces sauts de langage me sont essentiels pour différentes raisons. J’adore la langue française, je la trouve d’une richesse absolue. J’ai la chance de parler plusieurs langues et je trouve que la langue française permet de jouer avec les mots, de sorte à faire des jeux de mots, des dérapages contrôlés ou incontrôlés. Cette langue est l’expression de notre liberté, de notre côté un petit peu, pardon pour le côté cliché, rebelle. Quand je dis kiffe, c’est un mot que je… kiffe justement, c’est exactement ce que je ressens. Et si je parle de poncif, de laborieux, de mots éventuellement plus recherchés, c’est que la langue française me permet de les avoir à portée de main pour exprimer très exactement ce que je veux dire et ce que ressentent mes protagonistes. J’aime cette liberté qui permet de piocher le mot adéquat. Gloria, ça m’a beaucoup plu de lui inventer un langage très imagée, en couleur, pétillante.
Vous parlez de plusieurs sujets sérieux, comme la maladie, le racisme ou encore les addictions (comme celle des jeux d’argent ou l’alcool), et pourtant vous en parlez avec légèreté, pourquoi avoir utilisé ce ton ?
On peut dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, et sans les mettre sur un registre larmoyant. Ce qui est vraiment fondamental, c’est la légèreté, car avec elle, on arrive à dépassionner, à dédramatiser. La maladie est un sujet qui nous touche tous ; pour autant, comment répondre à la chose impossible qu’est la mort, comment tenir le coup face à la maladie ? Eh bien en imposant la vie, avec tout ce qu’elle a de brinquebalant, de déstabilisant. Carmen, par exemple, ce qu’on va retenir d’elle, ce n’est pas son Alzheimer, c’est tout le bien qu’elle a fait. Je préfère en parler de façon légère pour que le lecteur se disent « On ne s’arrête pas à ça ». La valeur principale pour moi, c’est vraiment l’entraide. Dans ce café, ils sortent de leur coquille, de leur personnage pour aller vraiment vers la personne.
Alors qu’aujourd’hui Marianne Granier va bientôt franchir la barre des 10 000 ventes avec son premier roman, elle vient de terminer le second en novembre 2021. Pourtant, elle est encore à la recherche d’un éditeur.