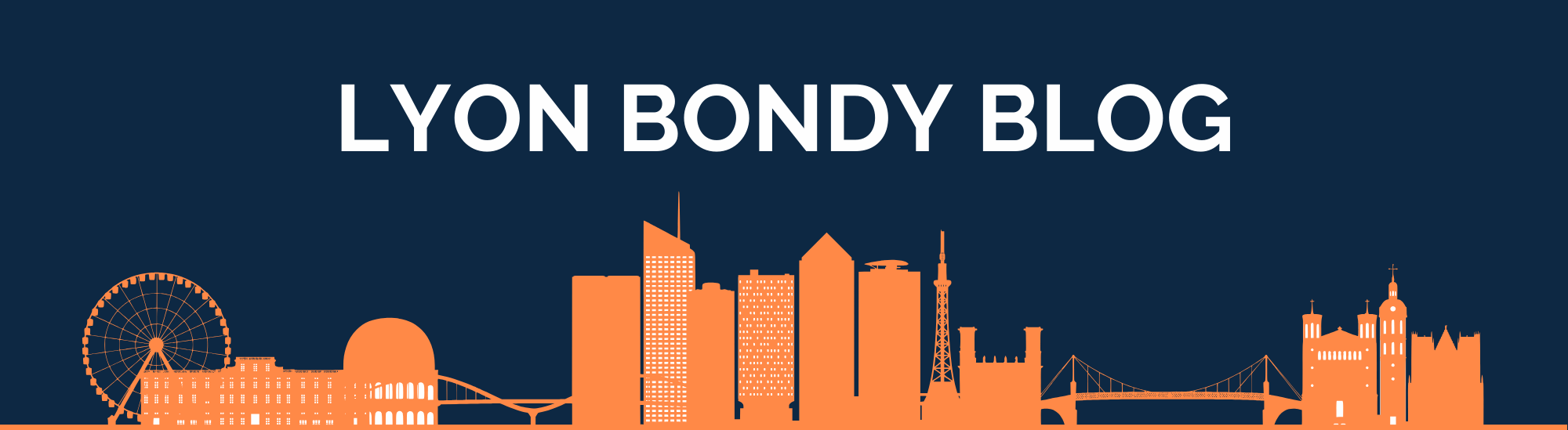Le 24 février 2018, Wahid Chaib a présenté Si on se disait tout sur les planches du Théâtre national populaire de Villeurbanne. Le metteur en scène, également chanteur de Zen Zila, exposait son travail en partenariat avec les habitants du quartier de Saint-Jean de Villeurbanne. Ranimer la mémoire, reprendre la parole et l’histoire de l’émigration dans le contexte français sont les thèmes au centre de ces œuvres. Après dix-huit mois de travail, l’artiste et les résidents du TNP nous dévoilent des mots sur la réalité du quartier de Saint-Jean de Villeurbanne.
Le documentaire La Chaâba en 2016, inspiré du livre de son oncle Azouz Begag, Le Gône du Chaâba, a donné une ligne conductrice aux travaux de Wahid Chaib.

En parlant de Chaâba, pourquoi être revenu dans le quartier de Saint-Jean de Villeurbanne, deux ans après le documentaire ?
Je n’ai jamais quitté Saint-Jean. C’est assez bizarre d’ailleurs, parce qu’avec Zen Zila, j’ai eu pas mal de projets qui m’ont amené à voyager. Depuis sa création, le centre social a essayé de faire des projets comme celui-ci. On propage une vision positive de « l’autre côté » du périphérique. C’est une autre histoire de la France, celle des oubliées de Villeurbanne. Cette histoire remonte à l’arrivée de mon grand-père en 1949 dans le parc de la Feyssine.
Comment avez-vous convaincu les personnes du centre social de témoigner, d’écrire et de raconter leur propre histoire ?
Alors là, je vais mettre la casquette d’animateur. Ce que j’essaye de dire aux gens qui viennent travailler dans les centres de proximité et dans les quartiers populaires, c’est que les diplômes sont indispensables et je les félicite. Mais ils ne commenceront à travailler que lorsqu’ils auront la confiance des gens. Avant, tu faisais des chiffres, des statistiques, t’écrivais des mots et voilà!
Le documentaire De l’autre côté [suivant la pièce, ndlr], commence par cette phrase : « nous sommes à Saint-Jean, Villeurbanne, un quartier sensible, populaire. Depuis pas mal d’années, j’entends des mots-clés comme » initiatives habitants », « paroles d’habitants », mais on ne les entend jamais ! » C’est celle que j’appelle la majorité silencieuse, parce qu’il y en a toujours qui parlent à la place des autres. En discutant autour de ça avec mes collègues et personnes du centre, j’ai lancé le dialogue : « si je vous disais maintenant et si on se disait tout, de quoi vous parleriez ? » On est parti sur un enregistrement, puis on a commencé à écrire.
Qui est concerné en tant que spectateur et auteur ? Quand on vient voir votre spectacle, à qui parlez-vous ?
À la France, dans tout ce qu’elle représente. Il y a eu plein de moyens sociaux sur les quartiers mais très peu d’envies culturelles. Il y a toujours un projet social, il n’y a jamais de projets culturels. Quand j’interpelle les politiques, je leur demande : « pourquoi ne dit-on pas projet social et culturel ? » On me répond : « Oui, mais la culture, elle est dedans », évidemment pour les quartiers, hein ! Mais ça représente que quelques miettes de miettes et ce n’est pas important. Mon combat, il est là-dessus. Dans le film, je suis un peu dure quand je dis qu’on ne résume pas un maghrébin au fait qu’il fasse du couscous. « C’est bon, voilà 200 euros, fais ton couscous dans ton coin, ne nous fais pas chier »… non ! Viens au TNP, c’est cool aussi, l’un n’empêche pas l’autre ! C’est ça mon message !
Le travail de mémoire et les parcours migratoires sont plutôt au centre de vos œuvres, qu’est-ce qui change cette fois-ci avec Si on se disait tout ? Quelle est la nuance, quelle est la nouveauté ?
Je dirais que ça s’inscrit dans une actualité, mais en même temps qu’elle n’est que le prolongement de cette histoire. Je dis en voix off dans le film : « nous sommes à Villeurbanne, commune de l’agglomération lyonnaise, c’est ici que commence l’histoire de France de 25 familles algériennes ». J’ai écouté Benjamin Stora il y a très peu de temps qui disait que l’histoire de l’émigration devrait être enseignée dans les manuels scolaires. Ça permettrait… [geste de la main qui mime une projection, un avancement] . Voilà, ce spectacle, en tout cas je l’espère, s’inscrit dans l’actualité. Je suis dans une période de ma vie ou j’aime transgresser sans agresser. De toute façon, on ne sera pas écouté ! C’est hyper compliqué en ce moment, donc soit on participe à la tension ambiante, soit on essaye des choses avec de l’humour, tout en disant ce qu’il y a à dire ! J’ai choisi l’humour et je sais que c’est plus long que certains qui font beaucoup de bruit. Ce qui a changé, c’est qu’on est dans l’actualité. Encore une fois, c’est aussi une histoire de contexte. Je l’ai dit à mes acteurs. Il y a des gens qui font du théâtre depuis 20 ans et qui rêveraient de jouer à Saint-Jean de Bouisse et de transmettre un peu le côté artiste, puisqu’ils me connaissent beaucoup du côté social. Je leur ai montré que c’était un travail et qu’on peut attirer les gens dans des lieux comme le TNP. Je suis sûr qu’il y a pas mal de Villeurbannais qui vivent ici et qui n’ont jamais mis les pieds au TNP.
Que pouvez-vous conclure de ce travail que vous avez fait à Saint-Jean?
Ce que je peux conclure sur ce travail, c’est qu’il y a 15 ans, 20 ans, j’essayais d’alerter sur l’importance de la culture! Je pense que ce qu’il se passe à Saint-Jean, c’est la même chose en zone rurale. À Saint-Jean, tu peux aller faire du ski ; en zone rurale, ils n’ont rien, « walou » [« rien » en arabe]. Certains extrêmes les récupèrent facilement. Je discutais avec un chef d’entreprise qui a un poste important et qui s’intéresse au quartier, au social. Il aime bien que je lui explique comment je vois les choses, ce qu’il s’y passe. Il me dit avec beaucoup de recul ce qu’il se passe dans sa boite, car il n’a jamais mis un pied dans un quartier. La relation entre les gens est la même, sauf qu’il y en a qui viennent de la Méditerranée… ils sont plus bruyants, c’est tout ! Ce que je retiens aussi, c’est que les institutions sont une chose, mais que c’est surtout rencontrer des hommes et des femmes qui changent qui vous font avancer et grandir. Quand vous voyez l’accueil ici [au TNP, ndlr], je suis très content. Quand ils [les acteurs, ndlr] vont retourner dans le quartier, ils vont dire qu’ils ont été accueillis comme tout le monde. Ils n’en reviennent pas qu’on leur ait donné le code du théâtre. C’est peut-être perçu comme une réaction clichée, mais ce n’en est pas une ! Un cliché, c’est quelque chose que tu fantasmes, alors que là, c’est la vérité.
Cet échange démontre-t-il qu’il y a une marque de confiance qui s’installe ?
Je suis persuadé qu’au moment où tu décides de faire confiance aux gens, dans 95 % des cas, ils saisissent l’opportunité . C’est rassurant de se dire que l’on fait bien les choses, ça aide. Ce que je retiens de ça, c’est que le directeur du Rize a vu la pièce et qu’il nous invite à jouer dans ses locaux.
Dans une de vos chansons, La joie de traversée, vous dites « partout on est chez nous, sans oublier qu’on est chez vous ». À qui parlez-vous et pourquoi ?
[Rires] Voilà, c’est fait pour ça ! Ça parle à qui veut l’entendre. C’est de l’humour, c’est de l’ironie. Je fais partie de cette génération où les chibanis, les anciens, étaient invisibles. Je crois que cette invisibilité elle continue, ou alors on veut rendre visible ce qui n’est pas intéressant. Ces anciens nous disaient « attention, tiens-toi bien, t’es pas chez toi ! » et je suis devenu Français. Il y a beaucoup d’ironie autour de cette phrase. Après, de manière instinctive, j’ai réfléchi à la volonté de savoir d’où je venais, qui j’étais. Pas pour me fermer, mais au contraire pour m’ouvrir aux autres. Dans le spectacle, je fais dire ça à une de mes actrices : « comment veux-tu subvenir à ton avenir si tu ne connais pas ton passé ? ». L’écriture, la musique et ces recherches ont fait de moi l’homme que je suis aujourd’hui. Je me rappelle de ma première signature chez Universal où l’on écoute un titre avec le patron du label. C’est à propos d’El Ouricia, une ville de l’est de l’Algérie. J’étais avec ma pote Diane Delauney qui est violoniste. Elle s’émeut et je lui demande ce qui lui arrive, elle me répond que c’est l’histoire de son grand-père, mais que lui venait d’Italie.
Qui sont Noria et Foued ? Vos enfants ? À qui avez-vous dédiée la pièce ? Pourquoi leur avoir dédiée ?
Noria et Foued ne sont pas mes enfants. Je n’ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, parce qu’au contraire ça m’a donné de l’énergie. Pour mon premier album, une semaine avant de l’enregistrer, je perds ma sœur. Et là, j’étais en pleine résidence, j’ai perdu ma cousine qui s’appelait Noria, c’était l’année dernière. Il n’y a pas très longtemps, le père d’un des acteurs est mort. C’était quelqu’un qui a été très proche de moi. Pour l’anecdote, je m’étais fait passer pour son frère. L’administration voulait le virer de l’école, il était en bac pro. Il a eu son bac de plombier et c’est devenu un très bon dans son métier. Il est parti brutalement il n’y a pas si longtemps. Ça me donne de l’énergie pour continuer. C’est pour montrer que je n’oublie pas, que je n’oublie personne.
Est-ce dédier la mémoire des anciens pour les suivants ?
Ce n’était même pas des anciens, ils étaient très jeunes tous les deux. Chaâba était dédiée à Bouzid et Saïd. Ce sont deux pionniers, mon grand-père et mon grand-oncle, qui étaient arrivés à Villeurbanne. C’est aussi simple que ça.