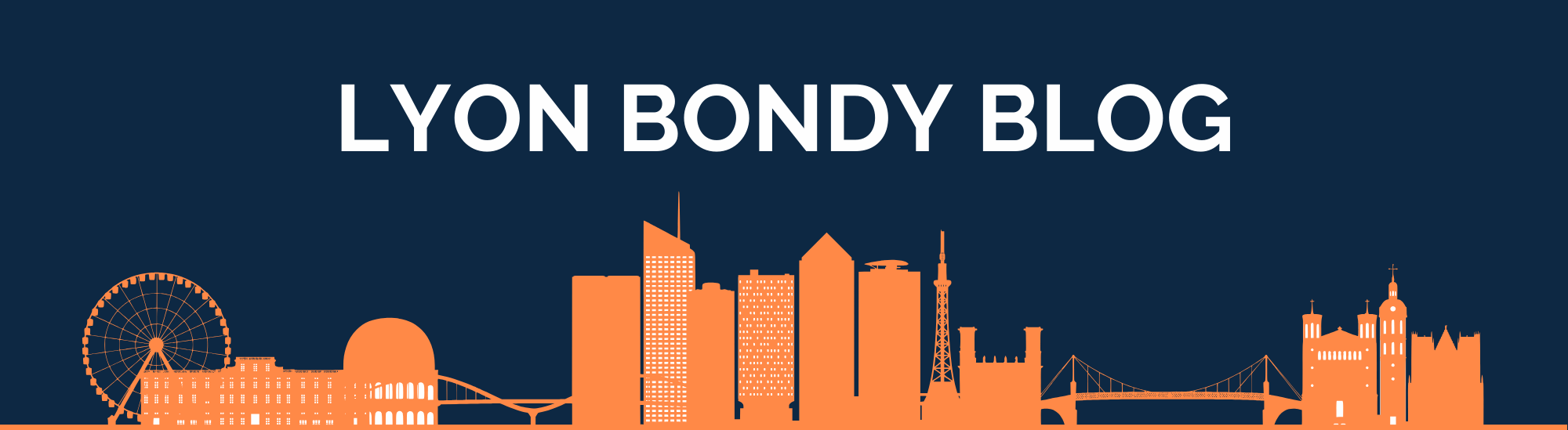Ses parents voulaient qu’elle devienne médecin. Elle est devenue députée européenne. Mais Djida Tazdaït est avant tout une militante associative et une dame au grand cœur. Même si elle n’a pas marché, cette lyonnaise d’adoption a été de tous les combats pour l’intégration. Comme un virus qu’on attrape, comme une vocation qui se révèle, son engagement prend racine dans une France post-coloniale dont une partie de la population n’accepte pas la différence.

Car, depuis 1945, le visage de la France a bien changé. Pour assurer sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, le pays a besoin de main-d’œuvre. L’ordonnance de 1945, relative à l’entrée et le séjour des étrangers en France accélère le processus d’immigration, particulièrement en provenance du Maghreb. Les flux migratoires s’intensifient avec la décolonisation, et notamment celle douloureuse de l’Algérie. La France est en guerre, mais le terme est tabou. Pour accueillir cette main-d’œuvre nécessaire à la croissance économique, l’État met en place des foyers de travailleurs migrants. La logique est simple : cette première génération d’immigrés n’a pas pour vocation de s’intégrer à la patrie. Pour elle comme pour la France, ces « foyers sont provisoires pour des travailleurs provisoires ». De fait, cette population n’ose pas revendiquer ses droits, se faisant discrète, rasant les murs pour continuer à travailler. Leurs enfants n’auront pas le même comportement. Ils se sentent français, avec ou sans la nationalité, et sont déterminés à prendre la parole pour l’affirmer haut et fort. Djida Tazdaït choisira la voie(x) associative.
Le combat associatif ou la lutte pour l’intégration
Djida arrive en France à l’âge de 6 ans à la suite des événements d’Algérie, résidant d’abord dans une cité transite à la limite de Lyon et Caluire. Elle n’a pas de carte d’identité française ( seulement une carte de résidence ) mais cela ne la bloque pas. Au contraire. Plus elle grandit et plus elle participe à la vie de la cité : « J’étais impliquée dans mon lycée, j’ai montée un ciné-club, j’ai participé à des manifestations lycéennes. Bien que sans papiers, je n’avais aucun doute sur mon implication citoyenne et sur mon appartenance à la France ». C’est après que le doute s’invite. Ou plutôt, la réalité d’une France qui n’a pas soignée ses plaies historiques qui s’affirme. Dans un contexte de crise économique, les années 1970 sont marquées par la banalité du racisme et de la discrimination, principalement à l’encontre des populations d’origines arabes. L’expression de cette haine est quotidienne, morale, physique, parfois mortelle, sans réaction ferme de l’administration française. Les relations de cette population avec les forces de l’ordre sont tendues. Le harcèlement policier est omniprésent, intense, rappelant certaines pages sombres de la guerre d’Algérie : « A cette époque, les contrôles pouvaient déboucher sur des « kidnappings ». Vous pouviez être « déporté » à l’orée de la banlieue pour être intimidé, tabassé voire torturé. ». Au lycée, Djida sent ce fléau « pointer le bout de son nez ». Elle en nourrit sa conscience et, à l’instar de ces amies militantes héritières de l’immigration, elle fait office de pionnière.
L’incompréhension accompagne la méfiance et la peur. En effet, l’enseignement secondaire est parfois le théâtre de scènes d’expulsions. « On voit des jeunes gens, comme nous, se faire expulser » témoigne Djida. C’est la prise de conscience de ce qui sera appelé plus tard la « double peine ». Celle-ci touche des jeunes étrangers : bien qu’ayant grandit en France, ces personnes sont passibles d’exclusion du pays en cas d’acte délictuel. Ils sont susceptibles de se retrouver dans un pays « étranger » qui ne les a pas vu grandir. Cette situation met au grand jour la complexité de la structure familiale : « au sein des fratries, il y a plusieurs statuts administratifs. Certains frères sont nés en France et donc automatiquement Français tandis que d’autres sont non-français car nés en Algérie. »
 Ce contexte global alimente l’engagement associatif de notre témoin. Elle s’interroge sur le droit de vivre en famille, émet le souhait d’une justice équitable. En 1979-80, avec d’autres jeunes, Djida lance un collectif informel, libéré des contraintes organisationnelles du militantisme classique. La structure regroupe un large éventail social et pas seulement des jeunes issus de l’immigration. Zaâma d’Banlieue se base alors sur la conception d’une lutte universelle, égalitaire et fraternelle : « Lorsqu’on dénonce les dérives de la Justice, les discriminations dans les institutions, c’est pour tous les Français. » Un credo initial qui va progressivement se dilater au profit d’un combat plus axé sur les jeunes issus de l’immigration.
Ce contexte global alimente l’engagement associatif de notre témoin. Elle s’interroge sur le droit de vivre en famille, émet le souhait d’une justice équitable. En 1979-80, avec d’autres jeunes, Djida lance un collectif informel, libéré des contraintes organisationnelles du militantisme classique. La structure regroupe un large éventail social et pas seulement des jeunes issus de l’immigration. Zaâma d’Banlieue se base alors sur la conception d’une lutte universelle, égalitaire et fraternelle : « Lorsqu’on dénonce les dérives de la Justice, les discriminations dans les institutions, c’est pour tous les Français. » Un credo initial qui va progressivement se dilater au profit d’un combat plus axé sur les jeunes issus de l’immigration.
L’association menée principalement par des femmes, les « Zâmettes » a pour objectif de faire bouger les lignes, avec bruit et intelligence : « Quand on ne nous entend pas, il est nécessaire de prendre le haut parleur et de crier ». Les mobilisations s’accompagnent d’un travail législatif précis et rigoureux : « Lorsque tu es certain de tes droits, tu peux les exiger sans concessions ». C’est un préalable nécessaire pour sensibiliser les avocats à leurs causes: revendications vis-à-vis de la police et de la Justice, contrôles d’identité abusifs et violences policières, solidarité avec les étudiants étrangers…
Début des années 1980 : tensions sociales et banalisation du crime racisme
A travers ce combat associatif, Djida et les siens rencontrent d’autres acteurs, notamment ceux de la Cimade (Christian Delorme et Jean Costil) fortement impliqués à Vénissieux : « C’était les deux têtes blanches qui dépassaient des manifs arabes et noires, ils étaient toujours là ! (rires) » ; mais aussi des jeunes du quartier avec qui elle noue des vrais liens d’amitiés même si les relations n’ont pas toujours été simples : alors que certains jeunes soutenus par la Cimade entament une grève de la faim en 1981 pour lutter contre les expulsions, Zaâma d’Banlieue s’opposera à cette idée critiquant « une forme de naïveté » (Journal « Zaâma d’Banlieue, n°1, mai 1983, Ndrl ). En dépit de certains désaccords, « c’est la bande » nous confiera t-elle 30 ans après. Une amitié qui se renforce au fil des épreuves.
Car, le début des années 1980 est mouvementé. Les quartiers populaires de l’agglomération lyonnaise s’agitent face à la tension policière, sociale, économique et politique (Le FN vient de percer aux municipales de Dreux). Et notamment aux Minguettes. Le 23 mars 1983, une bataille rangée entre policiers et habitants du quartier Monmousseau éclate. Une situation qui « dépasse l’entendement. Même les mères de famille tentent de protéger leurs enfants ». Dans cette conjoncture extrêmement tendue, une dizaine de jeunes prennent le contre-pied de la violence et entament une grève de la faim dans la tour 10 du quartier.

C’est « un acte de survie » pour alerter les pouvoirs publics sur la gravité de la situation. Cette initiative engendre la création de l’association SOS avenir Minguettes présidée par Toumi Djaïdja, futur initiateur de la Marche. Pour donner de l’écho à l’action des copains, tous les moyens sont bons. Ainsi, Djida et Zâama d’Banlieue n’hésitent pas à interpeller les médias en occupant directement les locaux de la rédaction de France 3 Rhône. Sur le terrain, en dépit de cette action pacifique, rien ne change.
L’« été meurtrier » frappe. A la Courneuve ( Seine-Saint-Denis ), Toufik Ouanès, un petit enfant de 9 ans est abattu par un ouvrier, le 9 juillet 1983 ; Toumi Djaïdja est blessé par balle par un policier, qui le laisse quasi-mort sur le bitume. L’immobilisme ne fonctionnant pas, les jeunes des Minguettes décident alors de marcher.
Loin de la Marche, près du coeur
Cette fois aussi, le collectif refuse de s’associer à cette action pacifique. Les divergences existent au sein de la structure : certains avancent la peur d’une récupération politique de l’événement, d’autres arguent « de la manipulation des militants chrétiens». Aujourd’hui, l’ancienne députée européenne tente d’expliquer le comportement des militants de Zaâma : « Nous avions parfois l’impression de ne pas pouvoir faire les choses indépendamment d’un « blanc saint ». A l’époque, notre comportement pouvait être ingrat pour ceux qui voulait nous aider ». Les raisons personnelles émises par Djida, trente ans après, complètent ce tableau. D’une part, elle doute de l’organisation : « Je pensais qu’on ne maîtrisait pas assez les institutions publiques et les réseaux politiques pour une telle initiative ». Elle s’inquiète aussi pour la sécurité : « Je connaissais le contexte sociale et politique en France. J’avais peur que, sur la route, un autre de mes potes prenne une balle ou soit victime d’une agression ». En somme, Djida éprouve un réflexe de grande sœur, elle, l’aînée de sa fratrie. Mais, face à la détermination de Toumi, Jamel et des autres futurs marcheurs, Djida ne peut qu’accepter leur décision.

Elle sera là, sans rancune et avec une immense fierté pour ses amis, lors de l’arrivée de la Marche à Paris, le 3 décembre 1983. Perchée sur un arrêt de bus, la « Zaamette » tente d’immortaliser le moment en prenant « (s)es potes en photos ». Avec le recul, Djida réalise l’impacte de ce périple piétonnier : « Avec leur détermination, ils ont forcé le respect de la France et des Français, et donc le mien. J’étais vraiment fière d’eux. En étant reçu par le Président de la République, ils étaient considérés comme des citoyens actifs, à la gloire de la France et de son égalité républicaine. C’était nos héros nationaux qui ne le sont jamais devenus ». Bien que la situation des citoyens d’origine maghrébine ne soit pas encore égalitaire, Djida veut voir « La Marche » comme une action qui a eu des répercussions positives sur la société française : « La carte de séjour à 10 ans, c’est un pilier essentiel de l’intégration » pour laquelle elle entamera une grève de la faim en 1986 lorsque Charles Pasqua menacera de supprimer son automaticité. Sur le plan judiciaire, la condamnation des crimes racistes est enfin effective, supprimant de fait une justice à deux vitesses : « Après l’affaire Bouafia, la justice équitable est passée, elle ne reviendra plus en arrière ». Enfin, Djida met en avant le fait que « la Marche a mit un coup de projecteur sur cette jeunesse qui a grandit à l’ombre des tours mais qui fait désormais parti intégrante de la société française. »
Le combat pour l’égalité continue, et dans les tumultes de celui-ci, certaines phrases ouïes au coin d’une porte donnent la force de poursuivre. C’est le cas de Djida Tazdaït qui a entendu un jour son fils dire : « Je ne douterai jamais de moi et de mes droits. Si un jour une personne dit que je ne suis pas un vrai français, je l’ignore, car j’ai la certitude que je suis là où je dois être et là où j’ai envie d’être ».