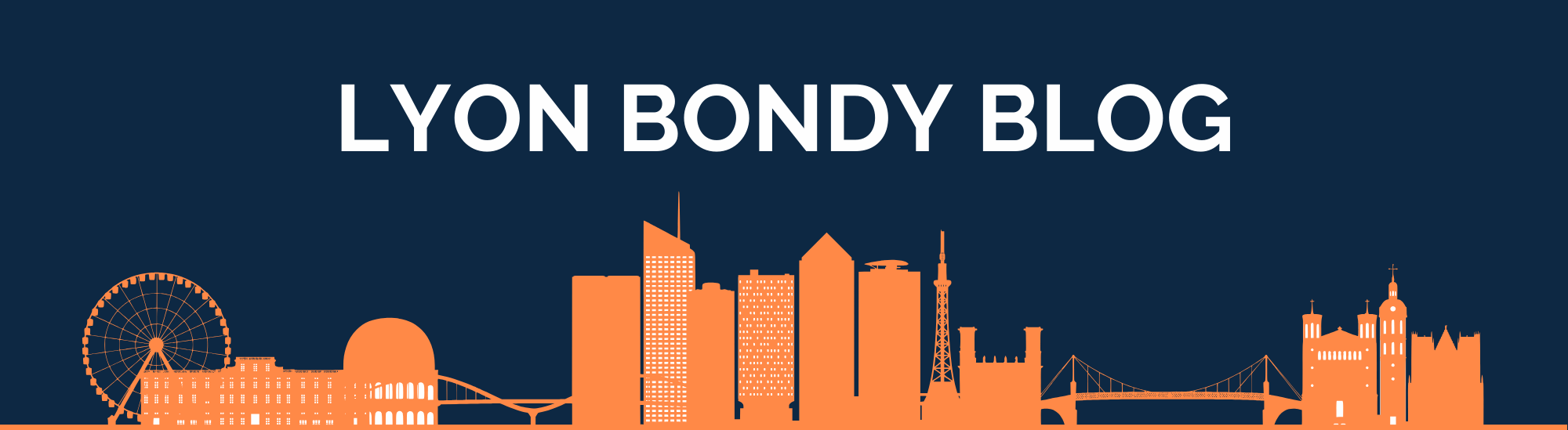Lor-K est une artiste urbaine qui est venue exposer ses œuvres au festival Peinture Fraiche de Lyon, se tenant du 3 au 12 mai à la Halle Debourg. A cette occasion, elle a accepté de donner une interview au Lyon Bondy Blog. Parcours, projets, créations, Lor-K a répondu à nos questions avec l’enthousiasme maladif que l’on retrouve dans ses créations.
Lyon Bondy Blog: : D’où vient ton blaze, Lor-K ?
Lor-K : Ça vient de Carole. Dans un miroir, si on le lisait dans l’autre sens, on entendrait ça. Je tiens à la sonorité K car c’est ce qui fait que je me reconnais quand on m’appelle Lor-K.
LBB : Raconte-nous ton parcours, comment en es-tu arrivée à faire de l’art urbain ?
Lor-K : J’ai toujours été fascinée par ce qu’il y a en extérieur. Je ne viens pas forcément d’une famille tournée vers l’art, je viens d’un milieu plutôt ouvrier et c’est vrai que n’ayant pas parcouru les musées et les galeries, ce que je voyais dans la rue ont été mes premières influences. Dès mon plus jeune âge, j’ai eu la curiosité de tester toutes les techniques que j’ai pu voir dehors. J’ai expérimenté tout ce qui était tags, graffitis, pochoirs, collages, bas-relief. J’ai testé plein de choses en fait, mais tout ce qui était sur un mur ne m’épanouissait pas. Je n’arrivais pas à dessiner avec la bombe, je faisais des créations mais il n’y avait pas de sens, c’était naïf et je ne trouvais pas de propos, de fonds.
LBB : À contrario, tu as trouvé dans les objets un moyen de faire passer tes messages ?
Lor-K : Oui, j’ai fait un parcours professionnel et je n’avais pas des très bonnes notes. Je n’ai pas pu me raccrocher directement à une filière artistique donc j’ai enchainé les stages en entreprises. C’est là que ça m’a donné ce regard sur la société de consommation.

C’est en entrant à la FAC que d’un coup, ça a fait « tilt ». Cela faisait des années que j’adorais poser dehors et que je ne trouvais pas ma patte, je ramassais tout le temps des objets et en même temps j’étais choqué par ce cycle de consommation actuel. Alors je me suis mise à utiliser ces objets pour le sens qu’ils évoquent dans la rue et pas pour les ramener chez moi et les désigner. Je ne voulais pas juste m’en servir comme support, vraiment les utiliser pour ce qu’ils peuvent évoquer et pour leur sens. Comme je dis souvent, la rue c’est plus un terrain d’expérience qu’un musée à ciel ouvert, car ce qu’il y a dehors n’est pas destiné à perdurer. À partir de là, est ce que c’est vraiment des œuvres d’art ?
LBB : Concernant les objets que tu trouves et que tu « cuisines », que deviennent-ils une fois terminés ?
Lor-K : Mon « process » comme on dit, c’est que je pars avec mon matos. J’ai mes outils, ma peinture, je suis en scooter. Dès que je trouve l’objet que je recherche, donc ça peut être un canapé, un matelas, un caddie, je m’arrête et je fais ma sculpture. Dès que j’ai finis je prends mes photos, mes vidéos et après je l’abandonne sur place. Si je le ramenais chez moi, personne ne le verrait, donc ce serait plus un happening plutôt qu’une forme d’art urbain. J’essaye d’axer les problématiques aussi bien sur le message que l’esthétique, de faire un « combo ».
LBB : Et sur le projet « Eat me » présenté au Festival Peinture Fraîche, quel est le message ?

Lor-K : Sur chaque sujet, on aborde des thématiques et des problèmes différents. Pour « Eat me », ça faisait déjà des années que je bossais dans la rue avec les déchets et je m’étais rendue compte que j’avais déjà intégré le matelas dans différents projets comme « objeticide » où je les avais découpés en lamelle et je les avais faits saigner. Finalement, le matelas est partout, dans plein de villes et c’est un objet que les gens n’aiment pas ramasser. Pour eux c’est le matelas où on crée la vie, où on meurt. C’est un objet que les gens considèrent intime. À partir du moment où il est sur le trottoir, tu ne vas pas le ramasser. C’est aussi un symbole pour ceux qui ne mangent pas à leur faim et qui dorment dehors. J’ai cherché un moyen de transformer cet objet qu’on ne regarde même pas pour le rendre appétissant, qu’il soit envié.
LBB : Tes œuvres ont été présentées dans plusieurs expositions et évènements, que penses-tu de cette première édition du festival Peinture Fraiche ?
Lor-K : C’est la première fois que je participe à un festival qui regroupe autant d’artistes dans le même secteur. C’est mon premier gros évènement collectif. Avant, j’avais souvent fait des expositions personnelles ou des spots où j’étais la seule à exposer. Ce n’est pas comme ici, où tu as une sorte d’énergie qui fait que tu brasses du public. Le fait qu’il y ait des artistes internationaux, plus de 70 artistes au même endroit, ça permet de brasser un public largement supérieur au public que je peux brasser habituellement. C’est également ici qu’on peut découvrir des nouveaux artistes, où d’autres qu’on connait déjà depuis 10 ans. C’est l’occasion de se rencontrer à Lyon. J’ai rencontré des parisiens, ça fait 10 ans que je les suis, d’autres ne me connaissent pas, et finalement on se rencontre ici, à Lyon.
LBB : Penses-tu que le street art en France soit encouragé, bien qu’il soit pour le moment illégal sans autorisation ?

Lor-K : Pour moi, pas assez. Aujourd’hui, il y a beaucoup de mairies, de centres culturels, d’évènements, ils te disent « on te paye les bombes, les bières et t’es content ». Sauf qu’à un moment il faut vivre. Je prends souvent l’exemple de la musique. Quand tu fais venir un groupe de musicien, tu les paye pour leur prestation. Pourquoi quand tu fais un évènement, une expo, un atelier, tu n’es pas payé ? Je pense que le street art n’a pas encore une assez bonne image, alors que ça fait des milliers d’euros en vente aux enchères. C’est plutôt un business et ce n’est pas encore totalement accepté et démocratisé. Par exemple, ici ils nous acceptent car c’est dans un terrain clos, mais la plupart des gens qui viennent à l’expo, si on est en bas de chez eux en train de taguer, c’est les premiers à appeler la police.
Et c’est ce décalage là que je trouve des fois un peu fou, entre l’expo où tu as ta coupe de champagne, et dans la rue où tu te fais presque insulter. Le chemin se fait petit à petit. Ce genre d’évènement permet de démocratiser la peinture, le graffiti. Au fur et à mesure des années, on va comprendre que c’est riche en techniques, qu’il y a aussi de la sculpture, du bas-relief, du numérique.
LBB : Il parait que tu préfères dire « art urbain » plutôt que « street art », pourquoi ?
Lor-K : Pour moi, le street art s’est tellement démocratiser que c’en est devenu un style. Aujourd’hui, tu peux acheter des torchons street art, un t-shirt street art, etc… Et je pense que ce n’est pas parce que tu fais du street art que tu as des problématiques urbaines, que tu abordes dans ton art des problématiques de la rue. Selon moi, la distinction se fait ici. Pour moi, l’art urbain c’est de s’exprimer en extérieur grâce aux arts plastiques. Mais ce n’est pas parce que tu vas poser dehors que tu es forcément un artiste qui aborde des problématiques urbaines.

LBB : Quels sont tes projets après « Eat me » ?
Lor-K : J’aimerai vraiment m’axer sur le projet « Delete ». Ce sont des pancartes imprimées. Toutes les images sont issues du numérique, il y a des smileys, des pages Windows, des mentions Instagram, etc… en taille géante. C’est une manière de faire le lien entre virtuel et réel. Car finalement aujourd’hui, la vie virtuelle a pris une place aussi importante que la vie physique.
Certains disent que le virtuel ce n’est rien, que c’est de la distance. Mais je ne pense pas, le virtuel te permet de communiquer, de rencontrer, de partager et on peut faire presque autant avec le virtuel, même si c’est différent, que dans le réel. Et c’est l’idée de « Delete », amener le virtuel dans le réel. Aujourd’hui s’il n’y avait pas le numérique, il n’y aurait pas autant d’artistes dans la rue. Le fait qu’on puisse prendre en photos et diffuser facilement ce que l’on fait, ça fait vivre le travail et le fait perdurer.