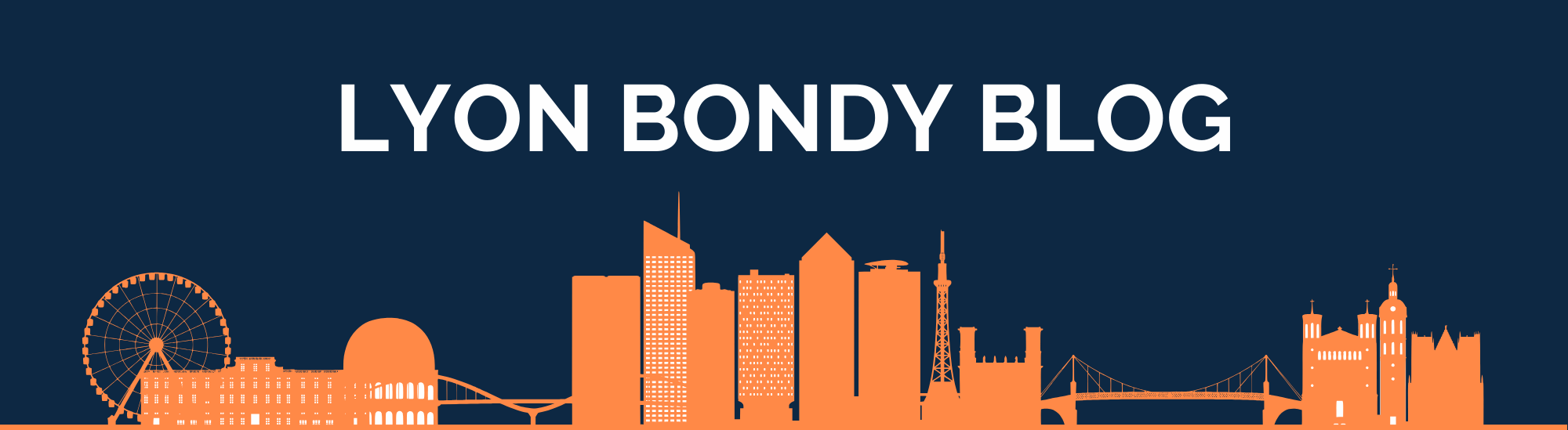Né au printemps 2019, le Comité contre les violences policières de Lyon a pour objectif de recenser et visibiliser les violences commises par les forces de sécurité. Mardi 17 novembre, il publiait une enquête sur deux années de suivi des plaintes contre la police en manifestation. Le responsable communication du Comité est revenu avec nous sur les conclusions du rapport.

Le Comité de liaison regroupe des structures et des individus[efn_note] Commission justice des assemblées des gilets jaunes de Lyon – Association des victimes de crimes sécuritaires – Collectif de blessés « Dévisageons l’état » – Caisse de solidarité – Ligue des droits de l’homme – Syndicat des avocats de France – Solidaires 69 – Collectif 21 Octobre – Planning familial 69 – Libre Pensée du Rhône – Collectif d’avocats : « les activistes du droit » – NPA – Ensemble – UD CGT 69 – Attac Rhône[/efn_note] qui entendent dénoncer les violences policières et les politiques qui les permettent. Ces deux dernières années, il a recensé des dizaines de témoignages de victimes et de documents issus des procédures judiciaires afin d’établir le rôle de la justice dans le cours des enquêtes. Intitulé “La Fabrique de l’Oubli”, le rapport pointe la difficulté des victimes à obtenir réparation : “non seulement la justice ferme les yeux, mais ses (in)actions conduisent bien souvent les victimes les plus tenaces à abandonner la partie, acceptant bon gré mal gré que leurs blessures tombent peu à peu dans l’oubli”.
Le rapport insiste notamment sur l’importance de la diffusion des images et la médiatisation des cas pour les victimes. Une dimension qui semble particulièrement d’actualité, alors que l’Assemblée Nationale doit voter le 24 novembre la proposition de loi relative à la sécurité globale, qui comporte une disposition controversée à ce sujet.
Entretien avec Lionel Perrin, du Comité de liaison.
Comment avez-vous conçu ce travail ?
C’est un travail de longue haleine, puisque le Comité existe depuis bientôt deux ans. Dès le début des manifestations des Gilets Jaunes, on a essayé de suivre les personnes qui avaient ete blessées et notamment celles qui avaient déposé plainte. On fait donc ce travail de suivi depuis un certain temps, ce qui a centré le rapport. Ensuite, on a passé entre 20 et 30 entretiens de personnes blessées. Soit de personnes qui avaient fait le choix de déposer plainte et qui ont obtenu le démarrage d’une enquête, soit de personnes qui ont choisi de ne pas déposer de plainte ou qui sont encore dans l’hésitation, afin qu’elles expliquent ce choix de ne pas saisir la justice. Évidemment, on a aussi questionné des avocats et utilisé un certain nombre de documents émanant des procédures d’enquêtes, comme les dépositions par exemple.
Depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes en novembre 2018, le Comité a identifié de façon formelle 78 cas de blessures par les forces de l’ordre au cours de manifestations. Parmi ces blessés, seules 23 personnes (un tiers) ont déclaré avoir l’intention de déposer plainte. Pourquoi sont-elles si peu selon vous ?
On a en effet identifié 23 personnes qui ont déclaré l’intention de déposer plainte. Après, ces chiffres-là sont partiels, on n’a pas prétention à l’exhaustivité : le nombre total de plaintes déposées est probablement beaucoup plus important. Les seuls à connaître les statistiques réelles sont les services du parquet de Lyon, qui refusent pour l’instant de communiquer là-dessus.
Le rapport met en lumière 3 séries d’obstacles qui conduisent non seulement au classement sans suite des plaintes et de manière plus générale au découragement des victimes elles-mêmes. Le premier mécanisme, qui se situe déjà en amont de la plainte, c’est qu’il y a une nécessité d’avoir des images pour aller devant la justice. S’il n’y a pas d’image, en général il n’y a pas de preuve et le procès ne peut pas aboutir : l’enquête n’arrive même pas à identifier qui sont les auteurs des tirs, des coups… Ce n’est pas vraiment nouveau, il y a déjà beaucoup de cas en France qui montrent que la parole des policiers est considérée comme parole d’évangile alors qu’on voit souvent que les images viennent démentir leur version des faits. C’est comme cela que la justice fonctionne pour l’instant, donc les images sont cruciales dans le cours des enquêtes.
Ce qu’on montre nous aussi, c’est que les images sont souvent nécessaires pour démarrer les enquêtes. Dans un tiers des cas qu’on a suivis, c’est la médiatisation des faits et non un dépôt de plainte qui a obligé le procureur de la République à ouvrir une enquête. Aujourd’hui, les défenseurs de la proposition de loi sécurité globale, et notamment de l’article 24, nous disent qu’il n’y a pas de soucis, qu’on pourra continuer de transmettre les images de la police à la justice. Pour cela, il faut déjà qu’elle soit saisie ! Or, si demain il n’y a plus de médiatisation des images, pleins d’enquêtes n’auront pas lieu. A Lyon, le cas d’école est celui d’Arthur, qui a été agressé par des policiers de la BAC en décembre 2019, place Bellecour. Il a voulu déposer plainte le soir-même en commissariat et s’est fait fermer la porte au nez. Il a téléphoné à la gendarmerie qui lui a dit qu’elle ne prendrait pas sa plainte. Suite à ça, il a alerté les médias photos à l’appui. C’est seulement après cette médiatisation que le procureur a ouvert une enquête. Sans ça, il n’y aurait pas eu d’enquête et les policiers ne seraient pas mis en cause.
Vous évoquez les différents services d’enquête, le Pôle Contrôle Déontologie et Discipline de la Direction Départementale (PCDD) et l’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN). A quel moment doivent-ils légalement démarrer une instruction ?
C’est une question essentielle. Les textes, que ce soit le Code de Procédure Pénale et la Convention Européenne des Droits de l’Homme obligent théoriquement l’autorité judiciaire du pays (en l’occurrence le Procureur de la République), quand elle a connaissance d’une potentielle infraction, de mener une enquête. Théoriquement, le procureur n’a donc pas besoin que quelqu’un dépose plainte : s’il a connaissance d’une infraction, il doit ouvrir une enquête. La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a produit une jurisprudence importante sur la nécessité de mener des enquêtes impartiales et effectives quand il y a des allégations de mauvais traitement commis par les forces de l’ordre. Il faut qu’une enquête poussée soit menée rapidement après les faits, de manière impartiale. La CEDH précise que l’autorité judiciaire doit elle-même déclencher les enquêtes. Théoriquement, il n’y a donc pas nécessité qu’il y ait une plainte. En pratique, on constate que la police cherche à connaître l’identité de toute personne blessée qui part avec les pompiers. Il y a donc beaucoup de cas de blessures parfois graves qui sont portées à la connaissance de l’autorité judiciaire, avec le nom des personnes et les circonstances approximatives des faits. Pour autant, les enquêtes ne sont pas déclenchées. C’est un vrai problème. Cela montre une mauvaise volonté manifeste du Procureur de la République pour mener et déclencher des enquêtes. Encore une fois, cela renvoie à la question des images : sans image pas de médiatisation, et sans médiatisation il n’y a aucun contre-pouvoir à la décision du Procureur qui reste tout-puissant.
Quelle est la différence entre une affaire traitée par le PCDD et l’IGPN ?
Si le Procureur décide d’ouvrir une enquête, il a le choix de saisir le service d’enquête qu’il souhaite, quel que soit le mode de saisine. Si demain vous vous faites agresser par la police dans la rue et que vous saisissez le formulaire de l’IGPN, l’IGPN transmet au procureur de la république et c’est toujours lui qui décide qui est saisi des plaintes. Il est le seul pilote en la matière, à Lyon ou dans n’importe quelle autre juridiction.
A Lyon, il y a donc deux services compétents. Soit c’est l’IGPN, le service le plus connu, qui a une indépendance toute relative mais qui est en tout cas un peu à l’écart du reste de l’organisation policière du Rhône. Soit c’est le PCDD, qu’on essaye de mettre en lumière dans notre rapport puisque c’est eux qui traitent la grande majorité des plaintes contre la police : quand il n’y a pas des blessures très graves ou des faits médiatisés, c’est eux qui s’en occupent. La majorité des cas leur incombent donc. Or, ils mènent des enquêtes beaucoup moins fouillées, et ils sont dans une situation de partialité totale puisque le chef de ce service est aussi celui qui dirige la police à Lyon. C’est donc compliqué, notamment dans des situations de manifestations puisque c’est à la fois lui qui pilote les dispositifs de maintien de l’ordre et qui signe et valide les enquêtes faites sur ces sujets-là. C’est complètement ahurissant : en termes de partialité, c’est difficile de faire pire !
Constate-t-on ensuite une réelle différence en termes d’issues des enquêtes ?
Ce qu’il y a de sûr, c’est que sauf exception les enquêtes n’aboutissent pas. A Lyon, on a un dossier qui va être poursuivi en correctionnelle, ce qui est déjà rarissime. Il y a plein de villes où il y a eu autant voire plus de violences policières et où il n’y a pas du tout de poursuite. Encore une fois, le cas d’Arthur repose sur une médiatisation incroyable. Que ce soit PCDD ou IGPN, on ne voit donc pas à ce stade de différence : les poursuites sont systématiquement classées sans suite. Après, on n’a pas encore assez de recul pour voir ce qu’il se joue derrière mais on constate que les enquêtes du PCDD sont beaucoup moins fournies que celles de l’IGPN. Même si elles aboutissent au même résultat, on a dans un cas l’IGPN où il y a beaucoup de matière pour rouvrir l’enquête, alors que c’est plus compliqué du côté de PCDD.
Dans le rapport, le cas de Valérie semble emblématique des problématiques traitées : pouvez-vous revenir dessus ?
Il s’agit d’une des rares personnes qui a déposé plainte directement au poste. Elle a été à la gendarmerie de son domicile dans l’Ain, donc assez loin du lieu des faits. Suite à cette plainte, elle a été poursuivie par les policiers qu’elle mettait en cause. C’est assez terrifiant, parce que les informations sur son identité et son domicile, qu’elle a communiquées dans sa plainte, ont permis de la poursuivre. Surtout, les policiers lui ont fait croire qu’elle était convoquée pour le suivi de sa plainte et ils l’ont placée en garde à vue ! Tout cela s’est finalement terminé assez bien pour elle, puisqu’elle a réussi à prouver que ce que lui reprochaient les policiers qu’elle mettait en cause était infondé. Elle a pu produire une vidéo qui montre qu’elle n’était pas là où les policiers disaient qu’elle était. Les policiers lui reprochaient de leur avoir jeté des projectiles dessus, et elle a pu démontrer avec la vidéo que c’était n’importe quoi. Elle a pu se dédouaner, mais elle l’a échappé belle. Ce qui est frappant dans cette histoire, c’est qu’elle a été mise en cause par les policiers qu’elle pointait du doigt, et que l’autorité judiciaire s’est complètement retournée contre elle. On ne l’a pas tenue au courant d’une enquête concernant sa plainte, tandis que dans le même temps on la placée en garde à vue, poursuivie en comparution immédiate… On est dans une situation où l’autorité judiciaire a agi déloyalement vis-à-vis de la plaignante, ce qui est à rebours des exigences de la CEDH, qui prévoit que les personnes qui se plaignent de mauvais traitement par les forces de l’ordre soient au contraire protégées par l’autorité judiciaire. Là, c’est tout le contraire qui s’est passé !
Le cas Valérie est également très révélateur de l’utilisation des caméras-piétons par les policiers. Au moment des faits, il y avait deux policiers porteurs de LBD, qui étaient donc équipés d’une caméra. Le policier qui lui a tiré dessus n’avait pas sa vidéo allumée et explique comme par hasard qu’il ne pouvait pas l’allumer avant parce qu’elle n’avait pas beaucoup d’autonomie, et qu’il n’a pas pu non plus l’allumer au moment du tir à cause de la confusion. Son collègue, lui, a une vidéo qui a servi à mettre en cause une autre personne au moment des faits, et qui a été produite dans l’enquête menée contre Valérie. Cela montre qu’évidemment, les policiers ne mettent pas à disposition de la justice les vidéos qui peuvent les incriminer. En ce qui concerne la vidéosurveillance de l’hélicoptère ou de la ville de lyon, c’est un peu différent. Il peut y avoir une chance que ces images servent à établir les faits, puisque ce ne sont pas les policiers directement impliqués qui décident ou non de filmer ou de transmettre les images.
Pourtant, les services d’enquêtes ont pu utiliser les images de la police dans le cas de Thomas ?
Même si le cas de Thomas a aussi été classé sans suite, c’est une anomalie au vu de la procédure. Il a été blessé en début d’après-midi le 9 mars 2019 et est parti à l’hôpital. Il y a eu tout de suite un signalement dans le cadre du dispositif de maintien de l’ordre, un équipage de police est allé le chercher à l’hôpital… Comme il y a eu une enquête diligentée au départ par des fonctionnaires du Commissariat du 7e, il se trouve que la Commissaire a donné l’ordre de poursuivre l’enquête en flagrance, c’est-à-dire que ce n’est pas passé par le Procureur, ce qui est très rare. C’est le service de police tout seul, de son initiative, qui a décidé de mener une enquête. Une fois que la machine était lancée, ils ne pouvaient plus l’arrêter. Pendant une quinzaine de jours, ce n’est ni l’IGPN ni le PCDD mais les services de police (la sûreté départementale) qui ont mené l’enquête. Comme ça a été fait en flagrance, ils ont fait tout de suite les actes d’investigation et ils ont eu rapidement accès aux vidéos. C’est une exception puisqu’on dit dans notre rapport, et c’est un élément essentiel, que c’est la rapidité des procédures qui permet d’accéder aux images. En général, elle dépend de la médiatisation des faits. Le plus souvent, le visionnage de vidéos prises par les forces de l’ordre est donc subordonné à l’existence de vidéos prises par les manifestants puisque sinon il n’y aurait pas d’enquête rapide.
Dans le dossier, vous soulignez qu’un cinquième des victimes de violence venaient de prendre des images de la police.. Doit-on craindre une augmentation de ce nombre ?
Il y a beaucoup de débat en ce moment sur la portée exacte de la proposition de loi relative à la sécurité globale. Les opposants, dont nous faisons partie, estiment que cela consistera concrètement à une interdiction globale, tandis que les défenseurs nous disent que “pas du tout, regardez bien le texte, il ne s’agit d’interdire que si ça nuit à l’intégrité du policier…”. Ces belles discussions sont intéressantes sur les bancs de l’Assemblée Nationale mais concrètement, c’est la police qui fait appliquer le droit dans la rue et dans les manifestations. Il est bien évident que la police va interpréter ce texte à la lettre ,quoiqu’en dise le Parlement, et qu’elle le considérera comme une interdiction pure et simple de prendre des images de la police. Sans ce texte, on est déjà à un cinquième d’agression qui concerne des gens en train de filmer. C’est évident que si la loi passe, cette proportion va se décupler. Les policiers vont se sentir légitimes, à tort ou à raison, de pouvoir empêcher qu’on les filme ou qu’on les prenne en photo. C’est cela qui est très inquiétant. Quelle que soit la portée juridique réelle de ce texte, qui est déjà problématique vu son ambiguïté, l’interprétation concrète en sera très violente de la part de la police.
Concrètement, cela risque-t-il de décourager les manifestants de filmer la police ?
De toute façon, la violence est dissuasive. Déjà, on sait que des gens ne vont plus en manifs parce qu’ils ont peur. De manière générale, l’omniprésence et le harcèlement physique opéré par la police est extrêmement dissuasif, donc c’est sûr qu’il en sera de même pour la question des images. Les gens vont avoir de plus en plus de mal et de crainte de prendre des images de la police, y compris – et c’est quand même à souligner – des personnes qui sont journalistes professionnels, avec cartes, et qui sont censées être protégées. En l’espace de deux ans, on est arrivés dans une situation incroyable ou les journalistes sont harnachés comme s’ils étaient dans des zones de conflit : casque, brassard, protections.. parfois même gardes du corps quand c’est des rédactions nationales ! On est dans une situation complètement folle, on n’a jamais connu ça en France. Il y a plein de journalistes qui nous l’ont dit par exemple pour Lyon : ils craignent pour leur intégrité physique, comme beaucoup de manifestants. Ils ont d’ailleurs raison, puisque [notre rapport] ne recense pas moins de 5 journalistes pris à partie en manifestation alors qu’ils faisaient leur travail et qu’ils étaient pour la plupart identifiés.
Concernant les méthodes de la police en manifestation, la proposition de loi relative à la sécurité globale porte aussi sur la surveillance par drone (article 22). Le Comité a-t-il une position sur le sujet ?
On ne l’a pas creusé dans le cadre du rapport, mais c’est sûr que l’utilisation des drones est déjà effective. Le fait que le Parlement examine des propositions de lois pour encadrer juridiquement l’utilisation des drones est une reconnaissance explicite du fait que jusqu’à maintenant, ils étaient utilisés sans aucun cadre légal. Sans contrôle des juridictions non plus, puisque le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé en disant que les drones ne devaient pas être utilisés… Et après cette décision, on a quand même vu à Lyon des drones survoler des manifs ! Le Ministère de l’Intérieur et localement les Préfectures se foutent du droit et de la jurisprudence qui sont censés les encadrer.
Ce qui est aussi notable, c’est qu’avec la proposition de loi, toutes les images vont être dans les mains de la police. D’une part, elle se propose d’empêcher les manifestants de filmer la police, et d’autre part de mettre beaucoup plus de moyens pour capter les images des manifestants et de les transmettre en temps réel aux centres de commandement avec les caméras-piétons, les drones… On va vers des dispositifs de maintien d’ordre totalitaires. La question des images, c’est la question du contrôle. Si une autorité a toutes les images, c’est qu’elle a tout contrôle sur les manifestants et qu’il n’y a plus aucun pouvoir. Juridiquement, la situation est insupportable ! On va être aux mains de forces de l’ordre dont on sait qu’elles vont être déployées dans la rue pour harceler les manifestants et faire taire la contestation sociale.
Retrouvez ici le rapport du Comité de liaison contre les violences policières.