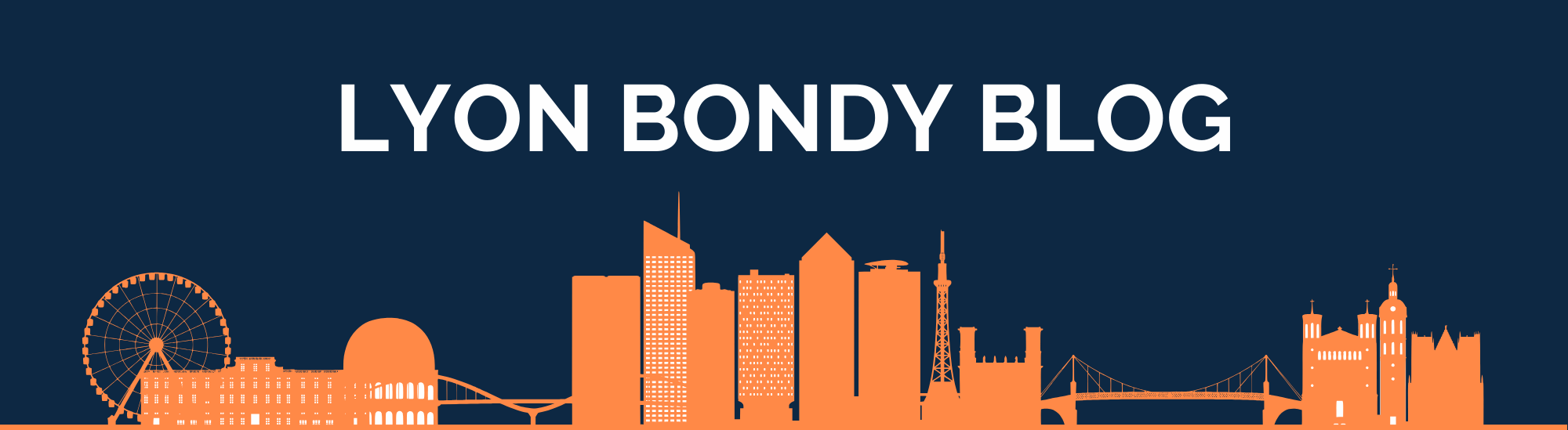Le 20 et 21 janvier, le ciné-concert Chaâba Project a eu lieu au pôle pixel à Lyon, l’occasion d’en apprendre plus sur le bidonville Chaâba de Lyon, où une vingtaine de familles algériennes s’est installée dans les années cinquante et soixante. Le concert, interprété par le groupe Velvet in the Bled accompagne la projection du documentaire « Chaâba, du bled au bidonville », réalisé par Wahid Chaïb.
Clap de fin pour le Ciné-concert Chaâba Project, une merveilleuse épopée visuelle et sonore qui s’est déroulée le 20 et 21 janvier au pôle Pixel à Lyon. Ses créateurs, Wahid Chaïb et Laurent Benitah, membres du groupe Velvet in the Bled, ont tenu à partager l’histoire de ce bidonville lyonnais surnommé Chaâba, dans lequel se sont installées vingt-cinq familles algériennes de 1949 à 1967.
En entrant dans le studio 24, on y découvre premièrement une exposition sur l’histoire de l’Algérie de 1961 à 2019. Ensuite, il y a la projection du documentaire « Chaâba, du bled au bidonville », que Wahid a créé en s’inspirant du livre « Le Gone du Chaâba » d’Azouz Begag. Le tout en étant animé par le groupe, les mélodies et paroles accompagnent à la perfection le récit des habitants du Chaâba.
Plus qu’une histoire, la mémoire des habitants du bidonville
Les lumières s’éteignent, un musicien entame une mélodie au luth, les notes mélodieuses aux influences orientales résonnent dans la salle. Puis Wahid entre en scène, sa veste en velours noir et son béret sur la tête, il se met à chanter en mêlant français et algérien. Les paroles évoquent sa relation avec sa mère, qu’il fait parfois souffrir et à qui il annonce devoir « avancer seul, sans me retourner ». Le public applaudit la performance puis tout d’un coup, des images sont projetées sur l’immense écran blanc. On y voit plusieurs endroits de Lyon comme la Feyssine, tandis qu’une voix les commente en racontant l’histoire de ces familles algériennes venues s’installer en France. Le chanteur déclare être le petit fils d’un de ces pionniers, qui ont vécu dans un bidonville de 1949 à 1967. S’en suit le témoignages d’anciens algériens qui nous apprennent que ce bidonville était surnommé Chaâba, qui veut dire « endroit perdu, nulle part, no man’s land… ». A la fin des trente glorieuses, beaucoup de travailleurs algériens débarquent en métropole en espérant trouver du travail. Dans les années 1950 à 1960, une grande majorité de ces travailleurs immigrés était très jeune et ils venaient souvent en famille. L’autre partie était majoritairement composée d’adultes célibataires, courageux de débarquer sur une terre dont ils ne connaissaient rien.
Les vidéos projetées sont des témoignages de ces travailleurs maintenant âgés et qui parlent de leur propre expérience. On parle de certains axes principaux de Lyon comme la Rue Ménin, où il est facile de trouver du travail, principalement dans le bâtiment. Durant un témoignage, la guitare reprend, rapidement accompagnée par le chanteur dont les paroles évoquent les questionnements de ces personnes là (combien de temps, où aller, que faire). Ils entendent dire dans leurs villages qu’il existe ces rues, « comme Garibaldi ou l’avenue Grambetta », énonce maladroitement un ancien, ce qui ne manque pas de faire rire le public. On leur dit que les possibilités de travail sont infinies et les perspectives sont multiples.
Une réalité plus difficile que prévu
La plus grande difficulté était de trouver un toit « rien n’était prévu au niveau de l’habitation et même du contact et de la scolarisation » énonce une dame âgée. Au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale, il y a une vraie crise du logement car la France doit se reconstruire et beaucoup des gens à la rue sont algériens. Ces individus ne pouvaient être logées ni expulsées, ce qui les motiva à construire d’autres maisons. Le bidonville est né d’un lieu-dit appelé le « bois noir » dans l’actuel parc de la Feyssine, une petite maison en dur autour de laquelle s’ajoutaient des maisons de fortune. Mais pour ces personnes aux origines modestes, c’était un bon début « même si c’était une baraque pour moi c’était un château » raconte une ancienne.
Ces gens-là ne savent ni lire ni écrire et ne parlent pas français, ils vivent pratiquement une situation d’esclavage dans leur pays, où ils travaillent dans les fermes pour se nourrir et n’étudient même pas. Ils ne connaissent rien au monde, ne connaissent pas la géographie ni l’orientation mais décident de quitter leur pays pour un autre. « C’était pour donner un minimum de chance à leurs enfants d’avoir des opportunités dans un autre pays, une autre culture, wow quel courage ! » annonce Azouz Begag, chercheur et écrivain. Petite pause musicale, le projecteur s’éteint et la guitare et le chant reprennent, les paroles évoquent la situation d’un « exilé pour toujours ». Le reportage se poursuit, ces personnes, en arrivant sur place, ne s’attendaient pas à ça, c’était un terrain vague, le sol en boue et les habitations étaient en tôle. L’hiver était dur, ils « vivaient comme des bêtes » annonce un ancien habitant du bidonville. Il y avait une camionnette qui distribuait de la nourriture, et le strict nécessaire pour survivre. Malgré la galère, ils se sentaient chez eux, il y avait des gestes de générosité et de partage, en apportant des plats aux familles de la porte d’à côté. C’était un groupe, ils vivaient ensemble et tranquilles, ils fêtaient leurs fêtes.
On apprend que le grand-père de Wahid est en quelques sortes le fondateur de ce bidonville et est considéré comme chef incontesté et incontestable. Sa seule règle « ne pas se faire remarquer, être invisible, car les temps étaient troubles ». Autre pause musicale on montre des images de femmes, beaucoup avec leurs gros ventres, leurs enfants. Leur rôle était de s’occuper des enfants, faire à manger et faire le ménage, elles ne sortaient que très rarement du bidonville. Sept ans plus tard les 25 familles avaient constitué un groupe de 200 enfants, qui grandissaient dans un inconfort notable, il leur était impossible de faire leurs devoirs convenablement. Ils grandissaient dans des familles où il n’y avait aucun livre.
Louise Billotet, voisine du bidonville marquera à jamais leur existence en les aidant avec toutes ces problématiques liées à la langue. Pour noël, elle leur faisait des paquets avec des papillotes bonbons et autres offrandes. Louise était en quelques sortes une deuxième cheffe, elle était un lien « entre les habitants du Chaâba et le reste de la France » dit une ancienne. « Ces gens-là dans cette société rasent les murs, ils sont invisibles » « on ne nous regardait pas de travers car nous savions nous tenir ». C’était en politique qu’on disait qu’ils étaient les fautifs de la crise, c’étaient les boucs émissaires de la société. Les parents disaient aux enfants qu’il fallait étudier pour ne pas être ces « boucs émissaires », qu’il fallait prendre « l’ascenseur social ».
L’éducation comme porte de sortie vers un avenir meilleur
La première génération des parents dans l’immigration algérienne a cru en l’école, cette école gratuite leur permet de s’élever dans la société, leur rêve est qu’ils devinent quelqu’un de par cette éducation. Mais la réalité est tout autre, les autres enfants ne veulent pas leur tenir la main à cause du henné, mais « les parents voyaient leurs enfants tenir un livre et ils les savaient sauvés ». Le spectateur est très vite sorti du reportage par une guitare saturée, des images graphiques de la répression sont projetées. On y voit des jeunes algériens fouillés, les mains sur la tête, un tag sur un pont dit « ici on noie les algériens ». En 1945 va s’éveiller la revendication des Algériens pour leur indépendance. Et après maintes massacres ces algériens étaient déterminés à se libérer de cet empire colonial parfois répressif. Malgré tout, beaucoup de femmes continuaient d’avoir un regard bienveillant envers cette société. « Ce n’était pas une guerre contre les français mais contre l’empire colonial français, et ça a toujours été mal compris par la société française je crois », dit Christian Delorme prêtre du diocèse de Lyon.
Après l’indépendance de l’Algérie, tous ces algériens maintenant français sont devenus des étrangers aux yeux de la société. Sont mis en place des organismes comme le commissariat des étrangers, qui « s’adressaient parfois à nous comme si nous étions des indigènes ». En 1964, on commence à parler de grands ensembles. On ordonne aux habitants du Chaâba de détruire leurs baraques, c’était une vraie déchirure d’abandonner 17 ans de souvenirs et de dure labeur. Depuis une dizaine d’années on construit des HLM et ils sont donc séparés et placés aux quatre coins de la ville. Le mythe du retour au pays est toujours ancré dans leur cerveau, de retourner en Algérie, leur vrai pays, l’idée est renforcée par les inégalités vécues en France. Mais les conditions en Algérie ne le permettaient pas et les enfants nés en France ont leurs vies ici. « A quoi ça sert d’avoir de la mémoire, quand on a pas d’avenir » demande un enfant. Ce à quoi on lui répond que c’est une partie importante pour un homme pour se construire un avenir.
La mémoire pour éviter que l’histoire se répète
Il y a quelques années, l’unique souvenir de cette belle histoire était un arbre fruitier planté par le grand-oncle de Walid, « pour nourrir au présent mais aussi au futur ». Mais tout change le 21 mai 2022, une balade mémorielle est organisée dans le cadre de la capitale de la culture « Chaâba, Socle commun de l’exil ». Durant cet événement, l’histoire de ce bidonville a été écrite au récit national, il a fallu 60 ans. Pour finir, Walid chante une très belle chanson « j’aimerais tant que l’on s’en souvienne » résonne dans la salle, « ô pays de mon enfance… »
Beaucoup de spectateurs se disent touchés par cette question de « l’exil », chacun à son niveau s’identifie à cette histoire et c’est ce qui fait la force de ce documentaire. Peu importe les disparités dans les origines des spectateurs, tous s’accordent sur un point : l’importance du travail de mémoire.