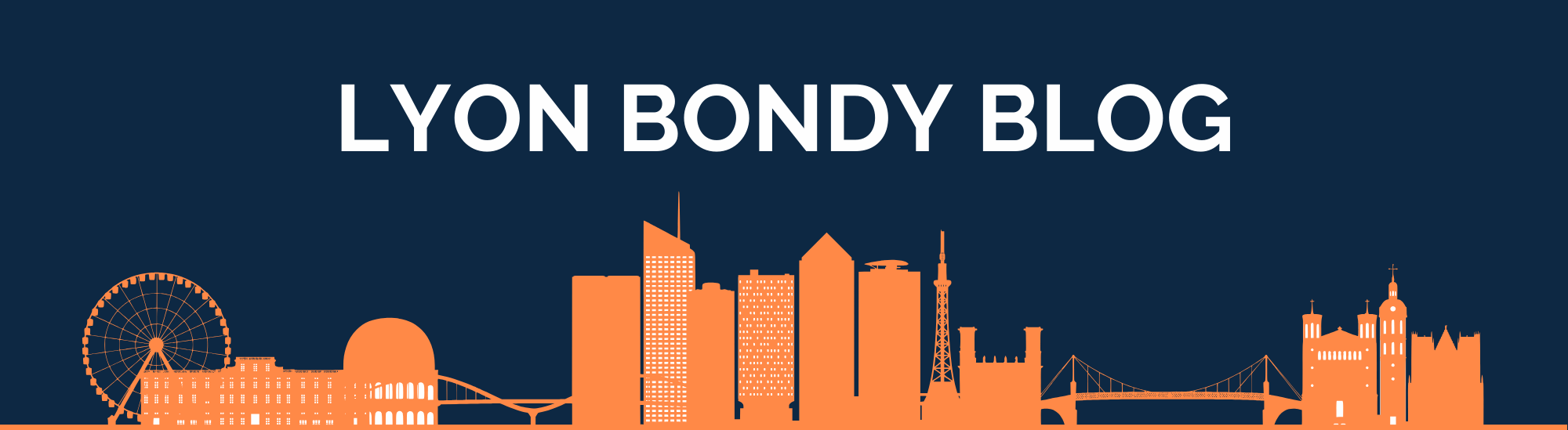Lors de la première biennale des cultures urbaines au Centre Culturel Charlie Chaplin, l’équipe du LBB est allée à la rencontre de Kadia Faraux, directrice artistique de l’événement et de la compagnie de danse. Elle nous parle du hip-hop, de la danse, de son parcours, des liens forts qui l’unissent à sa compagnie. Un témoignage empreint d’une véritable passion pour la danse que l’artiste transforme en moyen d’expression.
Pendant la soirée consacrée à la danse vendredi dernier, la compagnie Kadia Faraux a présenté son « work in progress » Slave No Limits. Une véritable perle de la danse hip-hop s’attaquant aux thématiques de l’esclavage, des rapports de pouvoir et des rapports de force.
Pourquoi votre choix s’est porté sur la culture hip-hop ?
Je suis autodidacte. J’ai commencé par le jazz, street jazz, claquettes, danse afro, danse orientale. Je me suis nourrie avec des feelings et des parcours de différents chorégraphes. Dans la vie, c’est important de savoir ce qu’on veut, de prendre le chemin pour atteindre nos objectifs, alors je fonce. C’est pour ça, que le hip-hop me parle ! Mais j’ai fait d’autres pièces comme Tartuffe(s) où j’ai beaucoup utilisé la musique arabo-musulmane, mes racines. Je reste ouverte, autant dans l’émotion et la sensibilité. Ce qui m’intéresse, c’est vraiment ce qu’on a à dire et de quelle manière. Le hip-hop, c’est une identité, des codes, des valeurs auxquels j’adhère et que je partage dans mon art.
Vous avez commencé la danse hip-hop dans les années 90, qu’est-ce qui a changé depuis cette période ?
Á l’époque, les filles n’étaient pas nombreuses et le contexte n’était pas le même. Les choses ont beaucoup évolué. Aujourd’hui, ce qui me choque, c’est d’entendre des discours des années 80. Le hip-hop est entré dans le théâtre, c’est une expression qui est une danse de virtuose. J’ai été surprise d’entendre aujourd’hui que les filles n’ont pas leur place dans le hip-hop, c’est absolument faux, parce qu’on est là.
Comment ça se passe au sein de votre compagnie, quelle est son histoire ?
Je travaille avec des danseurs que j’ai auditionnés. Il y a un noyau dur : trois danseurs qui ont déjà fait trois créations avec moi. Le talentueux compositeur qui signe ma troisième création, Franck II Louise, apporte une dramaturgique dans sa musique et matérialise le langage corporel. On fait en sorte de faire passer des sentiments et de l’émotion. Au niveau de l’esthétique, on est sur le rapport de force. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ça fait beaucoup écho à la révolte, à la contestation d’où Slave No Limits.
Quel est le message de la création Slave No Limits ?
Justement c’est qu’on ne doit pas être esclave de soi, ni celui des autres. En tant qu’artiste et chorégraphe, j’essaye de faire passer des messages forts, de montrer comment on ressent cette violence dans notre quotidien. Là, on l’exprime avec nos corps et avec une musique qui a une âme. Le hip-hop, c’est une danse viscérale. Dans notre création, il y a de mouvements très saccadés, très durs et des mouvements plus ronds. Il y a beaucoup de contrastes : une violence retenue, une autre lâchée.

En tant que chorégraphe, comment parvenez-vous à faire passer ce message à travers les danseurs ?
Nous sommes dans un rapport de confiance, c’est ce que l’on fait quand on est une famille. Pour aborder ces thèmes, on va chercher à l’intérieur de soi selon sa propre expérience. Donc je pars de ce que les danseurs sont, de leurs vécus. Je les dirige, j’ai un projet artistique et à partir de leur danse et de nos codes, j’essaye d’avoir une écriture chorégraphique. J’amène le mouvement, je le transforme mais sans dénaturer le danseur. Pour moi ce qui est important, c’est de trouver comment mettre une émotion, faire passer des sentiments en partant de la technique et des codes. Et c’est pour ça qu’on se fait confiance et qu’on travaille main dans la main.
Est-ce que vous travaillez avec d’autres compagnies de danse ?
Oui. Ça fait une vingtaine d’années que je suis sur le terrain, je transmets aux danseurs amateurs et professionnels, également en milieu carcéral. J’ai réalisé des projets avec Max-Laure Bourjolly, un des précurseurs de la compagnie Boogie Saï à Paris, Gabin Nuissier, Karima, la compagnie Aktuel Force. J’ai baigné dans cette culture. Aujourd’hui on a un grand travail de transmission à faire.